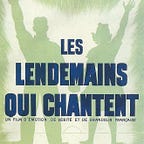Vers une économie de l’optimisation ?
Dans un récent article, Nicolas Voisin, fondateur de The assets, une start up qui vise à faciliter la gestion d’actif en pair-à-pair, propose d’appeler un chat un chat : pour lui l’économie collaborative ne serait qu’une économie de l’optimisation.
Si cette expression parvient à détrôner le concept du collaboratif, apparu finalement très récemment, cela va certainement mettre en colère les fondateurs de OuiShare qui militent pour une société collaborative. Par contre, tous ceux qui ne voient le monde qu’à travers des équations à optimiser s’en réjouiront.
L’optimisation environnementale
Parmi ces gens, il y a notamment les environnementalistes qui travaillent sur des impacts quantifiables, comme les gaz à effet de serre.Dans cette logique s’est diffusé récemment un vaste mouvement prônant le passage à l’économie circulaire, une économie qui optimise nos impacts environnementaux. Plusieurs modèles collaboratifs diffusés par le numérique participent ainsi à l’économie circulaire parce qu’ils “optimisent” la valeur d’usage d’un bien: c’est ce que font tous les modèles de partage de biens, de l’automobile à la perceuse, ou encore les modèles qui encouragent le réemploi à l’instar du boncoin qui facile la circulation d’objet d’occasion. L’optimisation dans toutes les dimensions de l’économie circulaire est susceptible d’impacts encore plus importants. Ainsi, la fondation Ellen MacArthur cherche à démontrer étude après étude, qu’en optimisant, l’économie circulaire est la solution aux enjeux environnementaux. Leur dernier rapport intitulé “Growth within” montre qu’en combinant solutions technologiques de l’optimisation (véhicules automatiques, drones pour l’agriculture…) et solutions organisationnelles issues de l’économie du partage (covoiturage, partage de locaux et même AMAP) les bénéfices environnementaux peuvent être énormes. Leur conclusion tient en un chiffre : -48%. C’est la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 auquel conduirait leur scénario d’économie circulaire pour la mobilité, l’alimentation et le logement. Un tel résultat a séduit la commissaire à l’environnement Karmenu Vella qui peine à défendre son objectif de -40% annoncé dans le cadre des négociations climatiques. Ainsi l’économie de l’optimisation en mobilisant technologies et nouvelles organisations en pair-à-pair devient un message d’espoir pour tous ceux qui s’alarment chaque jour des risques du changement climatique. Qui plus est, les bénéfices économiques apparaissent faramineux principalement parce que ce que l’économie circulaire optimise tout ce que nous gaspillons. Des véhicules et des logements mieux utilisés, de la nourriture moins gâchées sont les gages d’une nouvelle croissance “de l’intérieur”.
L’optimisation des organisations
Il n’y a pas qu’au nom de l’environnement que certains se réjouiront d’une telle reconnaissance. Ainsi pour les spécialistes du management, il y a de quoi s’enthousiasmer de l’avènement des nouvelles organisations “optimisées” par le pair-à-pair, le collaboratif et surtout les approches orientées utilisateurs: alors que le management hiérarchique montrait ses limites, les organisations plates font chaque jour leurs preuves pour développer des services et des produits à une échelle inimaginable jusqu’à récemment. Depuis les logiciel opensource à l’encyclopédie wikipedia, il est devenu possible d’associer sans structure bureaucratique une multitude de personnes qui viennent donner de leur temps pour un projet collectif. Cette logique bouleverse aujourd’hui tous les secteurs car elle peut être répliquées autant dans des services que dans la production de biens. C’est ce que démontre par exemple le projet wikispeed pour la conception d’automobile. Pour un économiste qui s’intéresse à la dépense publique, les promesses de l’économie de l’optimisation sont également énormes. Il y a déjà des économies à faire dans certaines dépenses, rien que pour les déplacements ou les bâtiments. Il y a aussi les espoirs d’une administration 3.0 qui se libèrera de sa bureaucratie. Et puis il y a des optimisations également importantes attendues dans les dépenses sociales. Ainsi face aux enjeux du vieillissement, l’économie de l’optimisation apparaît un grand soulagement : on pourra demain optimiser les dépenses de santé grâce aux technologies de quantified self et aux objects connectés qui permettront de rembourser plus ceux qui suivent correctement leurs prescriptions.
On le devine, ce monde idéal de l’optimisation ne fera pas rêver tout le monde et soulèvent déjà de nombreuses questions éthiques et politiques.
Va-t-on optimiser nos comportements ?
Commençons par ce débat éthique : peut-on laisser des entreprises et/ou des pouvoirs publics utiliser les nouvelles technologies pour “optimiser” nos comportements, même si c’est pour l’intérêt général ? En fait, ce débat n’est pas nouveau puisque Etats ou assurances utilisaient déjà des incitations ou des pénalités, voire les deux dans des dispositifs de type bonus malus, pour encourager les comportements vertueux. C’est ainsi le rôle des taxes sur le tabac, avec une efficacité en termes de santé publique somme toute réduite. Des réglementations ou des campagnes d’information jouaient le même rôle. Mais le numérique ouvre grand la boîte de pandore, notamment avec le pair-à-pair qui permet de s’appuyer sur chacun d’entre nous pour participer au changement de comportement de son prochain. A mon avis, cela ne servirait à rien de condamner ces solutions en blocs. Ce qui doit être par contre dénoncé, c’est plutôt toute tentative de mettre en place ces solutions de manière insidieuse, à l’insu des personnes concernées. Au contraire, chacune d’entre elles devraient faire l’objet d’un débat ouvert. Si une assurance dentaire met en place un bonus en fonction du bon usage que l’assuré fera de sa brosse à dent connectée, il n’y a pas de doute que la personne concernée le saura et pourra changer d’assurance s’il ne souhaite pas voir son comportements observé et jugé par son assurance. Mais si toutes les assurances imposent cette même brosse à dent, et que le consommateur n’a plus le choix ou doit payer plus cher pour une assurance qui ne lui impose pas de connecter sa brosse à dent, le débat doit remonter au niveau du législateur qui doit également s’appuyer sur une large concertation publique pour décider quelle régulation appliquer.
Optimiser l’homo oeconomicus
Il y a ensuite une question économique sur la pertinence du concept même d’économie de l’optimisation. N’est-il pas juste de dire que l’économie classique a toujours clamé que les acteurs économiques répondaient à des programmes de maximisation. N’est-elle pas fondé sur l’homo œconomicus, l’individu rationnel qui optimise à chaque instant son utilité ? De nombreux travaux ont démonté ce mythe : même les entreprises les plus organisées pour maximiser leur profit sont sujettes à des biais de rationalité. Qu’est-ce que l’économie de l’optimisation changerait à cela? Pourquoi serait-on entrer dans une économie qui réellement optimise ? Plusieurs réponses peuvent être envisagées.
Selon une première plutôt sympathique, la transformation de l’économie accompagne un changement culturel : le consommateur ne serait plus attaché à “avoir” et valorise plutôt l’ “être”. Dans le marketing, on dirait plutôt actuellement qu’il recherche la meilleure “expérience-client”. Celle-ci ne passe pas par la propriété mais par l’usage. Pour une entreprise optimiser sa rentabilité quand il s’agit de vendre l’usage d’un produit n’est pas du tout la même chose que de maximiser le profit sur la vente du produit. La logique d’optimisation s’est déplacée, offrant de nouveaux potentiels de développement économique.
Une autre réponse serait liée à l’ère de l’information et la possibilité de traiter des quantités toujours plus importantes de données. De nombreuses start up ont réussi parce qu’elles transforment l’accès à l’information pour les particuliers : finies les petites annonces déposées chez le commerçant ou collées au coin de la rue, des plateformes la rendent facilement accessible et nous permettent d’optimiser l’accès. Et pour une entreprise, grâce à une meilleure information, le traitement de quantité de données, à travers le big data, peut réduire les biais d’optimisation qui empêchait la pleine réalisation d’un modèle théorique de la micro-économie. Il devient aussi de plus en plus dangereux pour une entreprise de tricher, même si comme l’affaire Volkswagen l’a montré, les moyens de manipuler l’information sont de plus en plus sophistiqués.
L’optimum et le monopole
Une dernière explication peut se résumer à l’âge de la multitude comme l’intitule Nicolas Colin et Henri Verdier. La transformation actuelle serait fondée sur une nouvelle génération d’entrepreneurs qui inventent des modèles d’affaires bousculant les entreprises traditionnelles incapables de voir ou d’atteindre les gisements d’optimisation accessibles avec le numérique. La révolution schumpétérienne à laquelle nous assistons conduit au remplacement de conglomérats vieillissants par des nouvelles entreprises qui ont identifié les leviers d’optimisation et qui les utilisent à plein grâce à de puissants effets de réseau. Le hic, c’est que ces effets de réseaux conduisent alors naturellement à créer de nouveaux monopoles. Blablacar le montre : sa valorisation est estimée à plus d’un milliard de dollars, essentiellement du fait du réseau social de covoitureurs que l’entreprise a su constituer. Dans les deux premières réponses, on peut encore penser que les théories de l’économie classique sont conforter sur les vertus de la main invisible qui “optimise” l’intérêt général tandis qu’elle laisse chaque acteur maximiser son utilité en vendant ou achetant un bien au meilleur prix. L’accès plus facile à l’information permet de rendre plus crédible une hypothèse clé de cette théorie fondée sur une information parfaite. Il suffirait ensuite de remplacer les biens par des services dont le consommateur cherche à maximiser la valeur d’usage, et le tour est joué. Cependant, les très importants effets de réseau au cœur de l’économie de l’optimisation troublent cette belle mécanique. Peut-on encore nier que les plateformes ne sont pas compatibles avec une hypothèses d’une concurrence parfaite ?
Responsabilité fiscale — responsabilité sociale
Leur impact sur la redistribution des revenus est ainsi phénoménal : en bousculant des entreprises établies, elles menacent de nombreux emplois alors qu’elles-mêmes n’en créent directement qu’un nombre très réduit. Elles permettent par contre à une multitude de gagner en pouvoir d’achat ou de bénéficier de petits revenus issus des services rendus, de chauffeur, d’hôteliers, etc. Mais en même temps, leur valorisation capitalistique laisse penser qu’une partie non négligeable de la richesse créée reste entre les mains d’un petit nombre d’investisseurs. La généralisation du crowdfunding et en particulier de l’investissement participatif, permet d’espérer un meilleur partage de ces gains mais il est encore trop tôt pour évaluer quels sont les effets redistributifs. Surtout on peut à juste titre s’interroger sur quelle assiette fiscale un Etat pourra demain s’appuyer pour palier une redistribution insuffisante : si une part croissante des revenus se font dans la capitalisation de plateforme et dans du travail à la tâche permis par ces plateforme, pourra-t-on imposer une fiscalité juste et efficace qui compense la réduction associée des revenus du travail salarié? L’autre question posée par ces plateformes est la manière dont elles imposent de nouvelles formes de travail, le “digital labor” selon le titre du livre d’Antonio Casili et Dominique Cardon, qui pourrait aller jusqu’à une forme d’asservissement algorithmique. Mais en quoi cela présente des risques nouveaux ? L’optimisation selon les différents modèles qu’ils soient fordistes ou tayloriens, ont le plus souvent eu des conséquences néfastes sur la qualité du travail, et engendré des troubles importants. Compte tenu du coût de ces maladies, qui a pu être répercutés sur les entreprises par l’intermédiaire des assurances, ou pris en compte par les pouvoirs publics, des actions ont été mises en place pour réduire les risques, mais les nouvelles méthodes de management en ont produites d’autres. Aujourd’hui, l’économie de l’optimisation suscite une inquiétude supplémentaire: les travailleurs du digital sont une multitude pour l’essentiel en dehors de l’entreprise qui défini d’une certaine manière par l’algorithme les conditions de leur travail. Il est encore très difficile d’imposer aux plateformes une responsabilité sur les conditions de travail qu’elles engendrent, même si des actions récentes contre Uber laisse penser que le droit pourrait évoluer. Par ailleurs, tout n’est pas noir en matière de qualité de travail dans l’économie de l’optimisation : les nouveaux modèles peuvent aider les travailleurs à se libérer de structures hiérarchiques , en particulier de celles qui créent des “situations d’empêchement du travail” particulièrement pathogènes comme l’explique le psychologue du travail Yves Clot dans “le travail à coeur” ; l’économie numérique pourrait par ailleurs leur offrir de nouvelles ressources qui pourront aider à “restaurer du pouvoir d’agir”, selon l’expression d’Yves Clot. Le psychologue du travail recommande de favoriser des collectifs de travail où il est possible de débattre du “bien faire”, une condition pour la santé au travail, qui pourrait être facilitée par les réseaux sociaux s’ils sont utilisés à bon escient .
On peut ainsi sur nombres d’enjeux envisager des solutions pour que les plateformes numériques même en situation de monopole participent à l’“optimisation” de l’intérêt général, par exemple en mobilisant la fiscalité pour réduire les inégalités ou en facilitant l’action collective des usagers-travailleurs pour améliorer la qualité du travail. Mais les plateformes s’y plieront-elles? Il est certain que cela ne se fera pas sans qu’une pression d’une forme ou d’une autre soit exercée sur elle. Blablacar témoigne ainsi d’une responsabilité sociale accrue depuis que celle-ci a été remise en cause sur les réseaux sociaux. Airbnb prend également des mesures, notamment fiscales, en partenariat avec les villes qui ont commencé à sévir contre les locations irrégulières. Quant à Uber, le modèle devra évoluer suite aux multiples actions judiciaires à laquelle l’entreprise doit faire face. Il apparaît donc possible de renforcer progressivement la responsabilité sociale des plateformes par des actions conjointes des pouvoirs publics, de la société civile, des usagers/travailleurs/consommateurs.
La politique du commun, contrepouvoir de l’optimisation ?
L’enjeu est que cette responsabilité sociale s’exerce sur l’ensemble de leur chaîne de valeur, et prenne en compte tous les impacts qu’elles ont par leur algorithme sur les usagers et travailleurs, et au-delà. Ce qui peut rendre optimiste dans cette démarche, c’est que, bien que les effets réseau soient extrêmement puissants, l’actif réel de ces entreprises est très limité : l’essentiel de leur capital est constitué par la confiance que leur accordent leurs usagers. Il n’est pas impossible de répliquer les algorithmes mis en place, il est beaucoup plus difficile de conquérir leur réseau social, mais des actions intensives de communication appuyées par des plaidoyers pointant les manquement à leur responsabilité, peuvent véritablement fragiliser les monopoles constitués par ces plateformes.
Une dernière menace que peut poser l’économie de l’optimisation porte sur l’avenir de l’économie sociale et solidaire (ESS). L’économie collaborative est née de nombreuses applications non-marchandes qui a ce titre auraient pu être considérées comme des leviers de l’ESS. Pourtant leur audience apparaît rapidement contrainte par des modèles marchands. C’est le cas du couchsurfing, logement gratuit chez l’habitant, qui n’attire plus beaucoup de logeurs depuis l’avènement d’Airbnb. Une frange importante de l’ESS fondée sur la récupération d’objet est aussi concurrencée par les sites de partage et d’occasion. Il est possible que comme dans l’ancienne économie, un équilibre s’installe, l’ESS restant aux franges de l’économie marchande de l’optimisation.
Ce qui peut cependant inquiéter les acteurs de l’ESS attaché à mettre l’économie au service de l’homme, c’est que l’optimisation oublie justement l’humain. Quelle place laisse-t-elle par exemple à des “travailleurs non optimaux” ? ou à des usagers qui ne sauront mobilisés les outils numériques mis à leur service ? On le voit la logique d’évaluation généralisée dans tous les réseaux en pair-à-pair est implacable : une personne qui n’est pas à la hauteur de ce qui est attendu sera mise aux marges du réseau et ne pourra pas, ou beaucoup plus difficilement, profiter des services rendus par la plateforme. Face à ces évaluations omniprésentes, comment redonner de la place aux valeurs sociales et solidaires portées par les acteurs de l’ESS? Peut-être justement en considérant que les applications qui sont développées à la marge des plateformes payantes pourront aussi jouer un rôle accru, car elles-mêmes gagneront en efficacité sans rogner des objectifs d’inclusion et de respect de chacun.
Parler d’économie de l’optimisation est certainement utile pour ne pas se voiler la face sur les dérives possibles et nombreuses qu’engendrent les nouvelles organisations numériques qu’on range trop facilement sous le vocable de partage et de collaboratif. Sous de nombreux angles, cette économie reste désirable car prometteuse pour répondre à de multiples enjeux environnementaux et économiques. Mais leur impact social peut être violent.
Il ne s’agit pas d’attendre seulement une action des pouvoirs publics. Ceux-ci se trouveront toujours dépasser par la multiplicité des nouveaux modèles. Il faut au contraire s’appuyer sur la multitude qui peut transformer une plateforme monopolistique en véritable commun, en entreprise responsable qui sert l’ensemble des parties prenantes, mais aussi sur les multitudes d’initiatives qui peuvent générer de nouveaux communs s’appuyant sur le numérique pour innover en faveur des valeurs sociales et solidaires. Ainsi comme le recommande Pierre Dardot et Christian Laval, il faut une véritable politique du commun dans toutes ces dimensions, ou encore comme le propose Michel Bauwens, les pouvoirs publics doivent devenir partenaire des communs qui pourront s’émanciper en s’appuyant sur les technologies digitales.