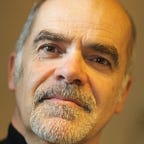La Revanche des “Deplorables” vue du campus de Stanford
Par Frederic Filloux
Les signaux étaient là, mais la presse, les élites intellectuelles et politiques regardaient du côté de la rationalité et du confort de pensée. Une terrible leçon que l’Amérique risque de payer cher.
Il y a trois semaines, j’ai parié avec un ami de Washington un bon dîner que Donald Trump l’emporterait le 8 novembre. Un pari plutôt à rebours du moment où les sondages donnaient une solide avance à Hillary Clinton. C’était avant l’annonce du FBI de la prochaine réouverture de l’enquête sur les emails de l’ancienne secrétaire d’Etat de Barack Obama. A mon interlocuteur incrédule, j’exposais ce qui était plus une intuition aux limites de la cohérence, qu’un raisonnement très construit.
“Pour moi, les signaux sont là, lui dis-je. Ils sont faibles, épars, pris isolément ils n’ont aucune valeur, mais je sens un truc flippant…”
Je suis un peu obsédé par ce qu’on appelle les “signaux faibles” qui sont souvent inaudibles (ou invisibles) dans un “bruit” ambiant (en anglais on dit “static” comme pour un son-parasite). Mon sujet d’étude à Stanford porte d’ailleurs sur les signaux sémantiques qui traduisent une notion de qualité dans un flux d’information (détails dans la Monday Note). Comme beaucoup, je travaille avec ferveur sur comment sauver l’information de qualité du champ gravitationnel de la médiocrité numérique… Vaste tâche, mais on risque d’avoir fortement besoin d’un journalisme solide dans les années qui viennent…
Stanford est une bulle où tout n’est que quiétude, confort et bien-pensance. D’après un sondage publié par le Stanford Daily, 91% des étudiants se retrouvent dans le courant de pensée libéral (au sens américain du terme, c’est-à-dire progressiste), 85% comptaient voter pour Hillary Clinton contre à peine 4% pour Donald Trump.
Ce qui rend cet environnement intéressant dans le contexte du séisme politique d’aujourd’hui est précisément qu’il est typique. Avec d’autres paramètres ou composantes, ce genre de bulle se retrouve dans beaucoup de grandes villes, dans les universités et naturellement dans les medias.
En matière de signaux faibles, cet unanimisme des élites m’est apparu comme une première série de “signaux faibles”. Pour faire simple, la victoire d’Hillary était acquise et la doute n’était pas permis — au point que sont expression même apparaissait comme une dérogation suspecte à une pensée majoritaire, sereine et incontestable.
Je me souviens d’une soirée post-débat électoral où Trump avait été, une fois encore, complètement nul face à une adversaire qui égrenait avec aplomb le chapelet de ses talking points. Après le débat, nous avions organisé une discussion avec des étudiants de troisième cycle en sciences politiques et plus particulièrement spécialisés dans les sondages. S’en est suivi un échange fort intéressant, mais un peu stérile dans la mesure où tout le monde était sur la même ligne: Hillary allait l’emporter, le tout était de savoir avec quelle avance…
La remise en question de l’implacabilité des pronostics étaient accueillie avec une urbanité californienne. Lorsque je hasardais le fait que, sur la base de l’expérience française (où malheureusement on en connait un rayon en matière d’extrême-droite) il pouvait exister un vote caché en faveur de Trump, la réponse était une dénégation polie: “…Ah, oui, ici ont appelle cela le Bradley Effect [du nom du maire noir de Los Angeles qui a perdu l’élection au poste de gouverneur en 1982 alors qu’il était largement en tête dans les sondages]. Mais ça ne joue pas ici…” Très bien, allons-y.
Confiance, mais aussi défiance face aux voix dissonantes. Ce soir-là au quatrième étage du McClatchy Hall de l’université où se trouvent une partie des sciences humaines, un homme d’apparence moins cool que les jeunes passionnés de sondage vient refroidir l’ambiance en évoquant une étude produite par l’University of Southern California et le Los Angeles Times. Ce sondage, apparemment hérétique, est construit selon une méthodologie différente: là où les autres études changent de panel à chaque sondage, celui-là examine le même échantillon et on peut donc mesurer les variations sur la durée. Problème, il donne Donald Trump en tête, et de façon régulière. Son défenseur impromptu, lequel est un peu suffisant dans son propos, est presque conspué. Il est vrai qu’il gâche un peu la fête.
Au final, le fameux USC Dornsife/LA Times se révèlera certes un peu trop généreux en faveur de Trump, mais bien plus exact que les autres. Voici sa physionomie le 6 novembre, deux jours avant le vote:
…Dans le même temps, non seulement les autres instituts prévoyaient un score exactement opposé, mais les baromètres sur les chances de victoire démocrate étaient juste effarant de certitude:
Ce gouffre entre les intentions de vote et les chances estimées de victoire m’est apparu comme un signal sinistre. D’un côté, une majorité d’instituts donnait 45~47% des votes en faveur d’Hillary vs. ±43% pour Trump — c’est-à-dire en plein de la marge d’erreur — de l’autre, les chances de victoire démocrates étaient évalues à plus de 80%. Tout cela me semblait totalement hors sol. (Comme on sait, Hillary remportera bien le vote populaire avec 47,7% contre 47,5% , mais Trump obtiendra 279 grands électeurs contre 228 pour Clinton après avoir fait basculer quelques états-clés).
A cet indice plutôt fort s’en ajoutaient une séries d’autres, parfois anecdotiques, mais qui finissaient par former un nuage assez sombre — en tout cas bien opaque.
Tous les matins pour rejoindre le campus, je traverse en vélo cette enclave cossue de Menlo Park et Palo Alto, deux villes où la moindre maison coûte plusieurs millions de dollars et où un appartement de 40m2 se loue 3000 dollars par mois. Jardins manucurés avec palmiers ou eucalyptus, Mexicains armés de souffle-feuilles dès l’aurore, une quinzaine de Teslas sur mon parcours, un chômage négatif à trente kilomètres à la ronde, et un solide fief démocrate. Pourtant aucune affiche pour Hillary (ni pour Trump évidemment). L’explication tient dans ce graphique:
Hillary est une candidate détestée. Moins que Trump, qui en plus fait peur (à juste titre), mais elle incarne la prévarication, le mensonge permanent, l’enrichissement personnel au moyen d’un mélange des genres systématique et poussé sur une longue durée. Pour paraphraser Jean-François Revel qui parlait de Mitterrand: un gérance plus qu’une gestion. J’interroge des amis habitant dans des bastions démocrates ailleurs dans le pays: pas ou très peu de fanions Hillary sur les pelouses des jolies banlieues. Pas d’affiche pour Trump non plus. Aucune valeur statistique évidemment, mais un sentiment diffus: une bonne partie des électeurs vont aller voter Hillary en se pinçant le nez, pour faire barrage à Donald, tandis que les électeurs républicains se planquent…
Signal aussi avec cet étonnante couverture de Business Week qui raconte comment Trump a mis en place une organisation redoutable pour dissuader la frange la plus fragile des électeurs traditionnels de Clinton d’aller voter. Et l’enquête de citer le responsable de cette opération dite de “Suppression d’électeurs” qui raconte presque candidement:
“We have three major voter suppression operations under way.” They’re aimed at three groups Clinton needs to win overwhelmingly: idealistic white liberals, young women, and African Americans. Trump’s invocation at the debate of Clinton’s WikiLeaks e-mails and support for the Trans-Pacific Partnership was designed to turn off Sanders supporters.
Cette organisation s’appuyait aussi sur un vaste appareil de diffusion de calomnies dirigées contre Clinton — terreau il est vrai fertile — et concoctées depuis… la Macédoine. Cette enquête de BuzzFeed raconte comment des légions de geeks mercenaires, opérant à six mille kilomètres des Etats-Unis, bombardent les réseaux sociaux de fausse nouvelles, utilisant rageusement le formidable effet de levier de Facebook. (Un politologue de Stanford nous expliquait ce soir comment certains de ses collègues s’apprêtaient à plonger dans les monceaux de données pour évaluer l’effet de la redoutable combinaison calomnies mise à la puissance Facebook — prometteur.)
Autres indices, encore. Comme ce chercheur indien, Sanjiv Rai, spécialiste en intelligence artificielle qui a développé un modèle basé sur 20 millions de datapoints émanant de Google, YouTube et Twitter et qui prévoit une victoire de Trump après avoir prédit avec justesse le résultat de trois autres scrutins.
Dans le même ordre d’idées, Wall Street, qui a anticipé le résultat d’élections avec un taux d’exactitude de 86%, donne le Donald gagnant (cela changera dans des dernières heures, d’où une brève mais sévère panique sur les marchés à termes.)
A mon grand étonnement rien de tout cela ne semblait altérer la belle confiance des médias ou de mes interlocuteurs divers dans la victoire de la candidate démocrate.
Cette foi absolue dans l’issue du vote fut d’ailleurs la marque de fabrique de la campagne d’Hillary Clinton. Cela a donné une stratégie “inepte”, selon un politologue de Stanford. La candidate a négligé de se rendre dans des états supposés acquis aux Démocrates (et qui ont finalement basculé), mais elle a fait campagne dans des fiefs acquis aux Républicains (et qui le sont restés.)
Les propagateurs de cette hallucination collective sont évidemment des grands médias nationaux. Ils se sont livrés à une proctologie délirante sur les “data”; c’était à celui qui saturerait le plus ses lecteurs de sondages, de tableaux de bords, de graphiques psychédéliques, au détriment des grands enjeux, dont il est vrai, aucun des deux candidats n’était des incarnations enthousiasmantes.
En revanche, ces mêmes organes de presse ont multiplié les papiers sur la défaite claironnée de Trump et la médiocrité crasse de son électorat. Exemple, cette couverture de New York Magazine, forte mais embrassante au final:
Une ligne éditoriale consternante, aux antipodes du fameux journalisme américain — dont les fondements ont d’ailleurs volé en éclat pendant cette campagne. Ces choix résultaient de deux facteurs: en premier lieu une déconnexion historique entre le pays profond et ceux qui sont chargés de le couvrir et deux, l’érosion des forces journalistiques aux Etats-Unis. Un professeur de communication de l’université me rappelait aujourd’hui qu’en dix ans, l’ensemble des salles de rédaction américaines ont perdu au moins 40% de leurs effectifs et que si à Washington le nombre de journalistes a peu varié, une grande partie a basculé du côté des publications super-spécialisées, comme Politico Pro ou certaines newsletters dont les abonnements hors de prix garantissent une viabilité économique à défaut d’une couverture en profondeur du pays.
Cette rupture a été consacrée par Hillary elle-même lorsqu’en Septembre, elle avait qualifié les supporters de Trump de “Basket of deplorables” avant de s’excuser. Les “deplorables” se sont vengés. Ils ont renversé la table, brisant aussi des biens qui leur étaient précieux comme la couverture médicale universelle.
Le fameux Obamacare est imparfait, ce n’est rien de le dire, mais il a du sens dans un pays où un bébé prématuré coûte 1,5 million de dollars en soin, un pontage coronarien 370.000 dollars et une nuit aux urgence “simple” va chercher dans les 3000 dollars (ma source: des amis américains qui ont été confrontés à ces montants absurdes). Cette mesure, essentielle d’un point de vue sociétal autant que macro-économique a été méthodiquement sabotée par les Républicains. Donald Trump a l’intention de finir le job en abrogeant Obamacare, tout comme il veut détricoter la plupart des mesures-phares de l’administration Obama.
Un sinistre Après, dont nous parlerons dans quelques jours avec un regard sur le futur cabinet du Président Trump (deux mots encore difficiles à juxtaposer!), sur sa politique étrangère (si elle existe), sur les bouleversements redoutés à la Cour Suprême, la résilience espérée des institutions, et le gouffre d’incertitudes auxquelles l’Amérique et le monde sont confrontés depuis hier soir.