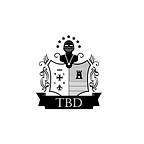Après le coronavirus, le déluge
La crise sanitaire du coronavirus, où l’arbre qui cache le gouffre.
Les marchés sont aujourd’hui extrêmement volatiles. La crise du coronavirus est en ce moment-même en train de servir de révélateur à une situation critique, mais loin d’être nouvelle. La crise du sanitaire qui s’abat actuellement sur le monde devrait sonner le glas de nos économies et déployer la prochaine grande crise économique. Cette nouvelle crise se devra de nous faire payer le prix des mauvaises stratégies adoptées durant les années 2000 et la crise des subprimes qui en avait découlé.
Depuis 2008, nos économies sont en effet en état d’immunodéficience. N’étant pas parvenues à utiliser l’aubaine qu’aurait dû représenter cette dernière crise en date, les économies n’ont pas bénéficié de ses vertues et n’ont pas su assainir leurs marchés. Elles ont délibérément fait le choix de fermer les yeux et de se reposer sur le dos confortable mais ô combien illusoire de la création monétaire, mère grasse d’une croissance de papier — et éphémère.
La crise de 2008, une nécessaire remise en cause du modèle capitaliste…
Douze ans plus tard, il semble recevable de penser la crise de 2008 dans l’Histoire comme une crise des inégalités de revenus.
Ces inégalités sont d’ailleurs à la racine de ce que nous qualifierons ici de problème étasunien. Le problème étasunien est — historiquement — un problème de construction et de culture économique. Cette culture économique s’est en effet construite autour d’un pilier tout puissant : la consommation. Alan Greenspan, directeur de la Fed de 1987 à 2006 s’est heurté à ce pilier. Afin de pallier la baisse de consommation des ménages étasuniens à partir des années 2000, Greenspan a orienté le taux directeur de la Fed à la baisse, garantissant ainsi étasuniens de maintenir voire redresser leur consommation, et donc une continuité dans leurs comportements économiques.
Cette politique de baisse des taux voulue par Greenspan aura eu, au début du millénaire, une double conséquence.
D’une part la création d’une croissance aussi arrogante qu’artificielle, menant la population vers une consommation excessive, hédoniste et foncièrement court-termiste.
D’autre part l’enracinement puissant de l’hégémonisme étasunien et d’un sentiment d’impunité cultivé notamment au sein des institutions financières, dont les profits connurent durant la période une hausse des plus grisantes. Une illustration — tragique — de ce sentiment d’impunité peut être trouvée dans une interview donnée par le CFO de Lehman Brothers, quelques mois avant la crise des Subprimes, où celui-ci assurait et proclamait qu’il était impensable que la société puisse perdre ne serait-ce qu’un centime sur ses opérations. (vous trouverez cet échange téléphonique dans le film Inside Job qui retrace la crise des subprimes et ses conséquences)
Cependant cette politique de l’argent facile aura, un temps, masqué une réalité cruelle du modèle étasunien : le salaire minimum/moyen étasunien ne permettait pas aux ménages de vivre décemment, les poussant ainsi vers un cumul d’emplois et, trop souvent — vers le surendettement, ce phénomène étant toujours d’actualité (https://www.youtube.com/watch?v=2WLuuCM6Ej0).
La baisse des taux intervenue au début des années 2000 n’aura permis que de maquiller, de manière criarde et éphémère, le cadavre déjà froid des inégalités croissantes et de l’état alarmant des finances des Etats-Unis.
En effet, lorsqu’à partir de 2004, Alan Greenspan, croyant que la situation était stabilisé, a amorcé le redressement des taux directeurs, les ménages les plus fragiles ont été étouffés. La suite, vous la connaissez : et s’en est suivi la pire crise financière connue par le jeune siècle — à ce jour…
Cette crise, par sa capacité de destruction, aurait dû amener dans son sillage une remise en question profonde et salvatrice du modèle capitaliste, où l’accumulation des richesses au plus près des arcanes du pouvoir mènera inexorablement vers ce type de crise.
… Qui n’a jamais eu lieu. Ou le récit d’un assainissement de l’économie avorté.
Cette purge était inéluctable. Elle n’a pas eu lieu, entravée par un interventionnisme massif des banques centrales à travers le monde.
A partir de 2010, la banque centrale étasunienne actionne la planche à billet. De manière plus ampoulée, nous pourrions également parler d’ “assouplissement quantitatif”, expression fourmillant en ce moment et utilisée pour qualifier les mesures économiques exceptionnelles, prises au coeur de l’ouragan Covid-19. A partir de 2010, donc, la politique de la Fed a visé à acheter en masse des dettes de l’Etat, dans le but d’écraser les taux au plancher et donc de relancer la consommation.
Ainsi, la Fed, suivit par les autres grandes banques centrales (du Japon, d’Angleterre et d’Europe) ont toutes joué la partition de l’assouplissement quantitatif.
Cette politique a eu pour effet d’apposer sur nos économique le maquillage moribond de nos réalités, déjà employé lors de la décennie passée. La croissance qui suivit ne fut que de papier. Bancale, précaire et illusoire. Cette croissance n’était qu’une croissance du bilan de nos banques centrales, en aucun cas une croissance réelle.
Comme l’illustrent les deux graphiques des bilans des banques centrales étasuniennes et européennes, les banques centrales sont encore aujourd’hui clafites de titres de créances, à ne savoir qu’en faire.
Les remettre en ventes afin d’alléger leurs bilans ? Cela créerait un choc qui conduirait à l’effondrement les économies.
Les garder en réserve ? Ce n’est en rien une solution au problème fondamental de nos sociétés qu’est la croissance des inégalités et nous conduirait inexorablement vers des crises de plus en plus fortes.
Aujourd’hui l’heure est au solde de tout compte.
Le choc du coronavirus nous ramène aujourd’hui à la réalité blafarde, cruelle, mais vraie.
Cette réalité est celle de pays dont les dettes sont incontrôlables et dont les économies sont exsangues. La concentration des richesses et l’absence de révolutions industrielles bénéfiques à l’ensemble de la population — la révolution de l’intelligence artificielle n’ayant pas bénéficiée aux classes les plus pauvres et ayant contribué à augmenter les écarts de richesse — ont conduit les états à s’endetter dans le but de combler l’écart entre leurs économies, malades, et une économie-chimère où les écarts ne seraient que bien moins importants.
Aujourd’hui et à cette heure, le confinement et l’urgence sanitaire nous couvrent d’œillères épaisses et camouflent le rééquilibrage nécessaire et inéluctable de nos sociétés. Dès lors que nos vies auront à presque-reprendre leur cours, nous aurons à faire face à la crise financière qui rôde et s’avance déjà vers nous.
La plupart des pays ont d’ailleurs commencé à annoncer des mesures de soutien à l’économie. (annonce de la relance face au coronavirus) Ces mesures, désespérément keynésiennes, toxiques, ne s’appuient que sur une création de dette massive et font, à nouveau, le choix d’ignorer l’assainissement nécessaire de nos structures et institutions financières.
Nous nous retrouvons rejetés vers une case départ qui porte tous les traits de 2008. Un scénario similaire, à la groundhod day, à la nuance près que le bilan de nos banques centrales ne leur permettent plus — autant — de faire fonctionner la planche à billets. Nos banques sont en effet face à un danger digne de prophéties collapsologues : celui de vider définitivement nos modèles économiques et monétaire de leurs sens.
De mon point de vue nous sommes face à une remise en cause globale de nos modes de production, et de consommation, qui devrait induire une remise en cause complète du capitalisme au profit d’un libéralisme salvateur où la collusion entre Etat et grandes entreprises n’aura plus sa place.
Il reste à savoir si nos banques centrales accepteront cette fois-ci l’inexorable marche du temps ou si elles prendront des mesures homéopathique, comme un n-ième “hélicoptère monétaire”, afin de trouver un remède à nos santés économiques vacillantes et à nos systèmes financiers déjà en état de mort cérébrale.